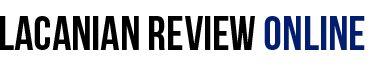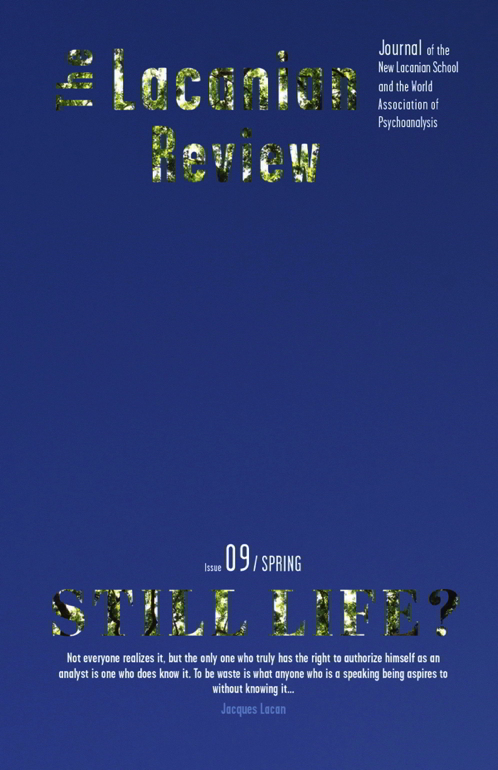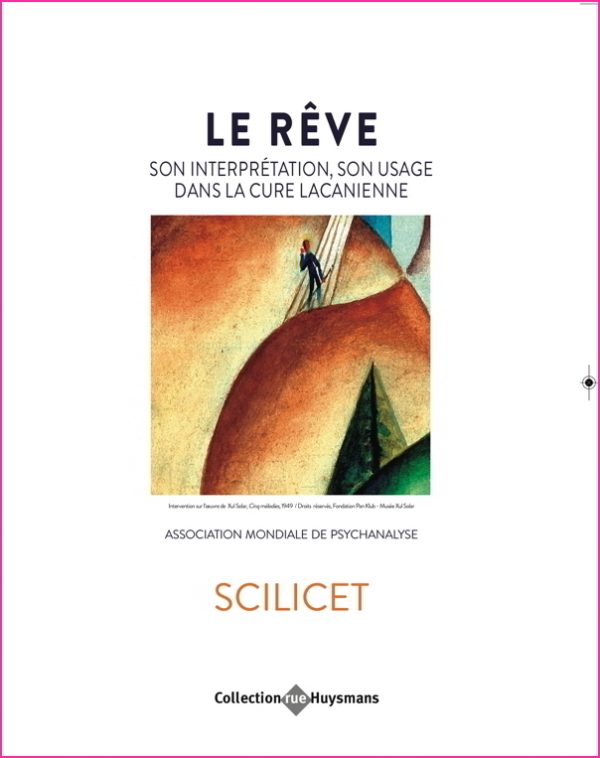Par:

Anne Béraud est psychanalyste depuis dix-huit ans et Présidente du groupe québécois associé à la Nouvelle École Lacanienne (NLS). Elle nous explique son parcours, son travail et sa vision critique du milieu psychiatrique québécois.
Dans son chaleureux bureau, entre deux consultations, Anne Béraud me reçoit avec beaucoup de gentillesse, surprise qu’un jeune collégien s’intéresse à la psychanalyse. Je m’installe dans un fauteuil (et non pas sur le fameux divan analytique, présent lui-aussi) et nous commençons.
Comment êtes-vous arrivée à devenir psychanalyste aux travers de vos études ?
Anne Béraud - D’abord, il faut savoir que pour devenir analyste, ce n’est pas par un parcours universitaire. Néanmoins, la plupart des analystes ont des diplômes universitaires. Ce n’est pas un diplôme de psychiatrie, de psychologie ou de philosophie qui donne la possibilité de devenir analyste. C’est un parcours parallèle au cursus académique.
Avec l’Institut psychanalytique…
Non, moi je suis lacanienne, et l’Institut psychanalytique, ce sont des freudiens. Ce sont deux univers parallèles et ce n’est pas exactement le même type de formation. Sans doute vous l’avez entendu à mon accent, je suis d’origine française. J’ai donc fait toutes mes études en France. Pour répondre à votre question, je suis obligée d’aborder ces deux points : il y a les études universitaires et il y a le parcours qui mène au fait qu’on puisse devenir analyste. Et ce dernier point relève de mon parcours singulier… Je suis un peu obligée de vous en parler.
Si ça ne vous dérange pas ?
Non, absolument pas.
Tout dépend de comment on rencontre la psychanalyse. Il se trouve que j’avais rencontré la psychanalyse assez jeune de par mon histoire familiale. J’ai un frère plus âgé qui était alors en terminale. En France, la philosophie est intégrée à la dernière année d’études avant l’université, et Freud en fait partie. J’avais dix ans et mon frère étudiait Freud et trouvait cela génial. Il en parlait à la maison. En l’écoutant, je me suis dit que c’est cela que je voulais faire; j’avais saisi quelque chose du concept d’inconscient. Très vite à l’adolescence, j’ai lu mes premiers livres de Freud. J’ai découvert, dans les livres et à travers les cas cliniques que je lisais, que je voulais devenir analyste.
J’ai étudié la philosophie au BAC et ensuite j’ai fait des études en psychologie, ce qui était la voie la plus simple pour atteindre la possibilité de la pratique clinique. En France, il fallait un DESS, ce qui correspond à un master-II, pour pratiquer. Ensuite, j’ai travaillé dans les institutions en tant que psychologue, dans un centre médico-psycho-pédagogique qui reçoit les enfants et les familles.
J’ai immigré au Québec en 1996, l’année où fut fermé l’accès à l’automatisation de la reconnaissance des diplômes français. Il fallait faire les équivalences et des cours en plus. Mais je devais travailler. Et entrer dans l’Ordre des psychologues du Québec - chose qui n’existe pas en France -, consistait à intégrer un fonctionnement qui ne me correspondait pas. Ce système de contrats avec les patients, et bien d’autres choses, me semblait complètement étranger à la psychanalyse. J’ai fait le choix de ne pas y entrer pour pratiquer la psychanalyse et avoir la liberté de pratiquer selon l’éthique psychanalytique et non pas en fonction des critères de l’Ordre.
Si je reviens à la psychanalyse, il faut donc faire une analyse pour devenir analyste, et elle est, je vais le dire crûment, longue. Il faut aller suffisamment loin pour pouvoir traverser un certain nombre de choses; ça ne se fait pas en quelques années. Ça prend du temps et on ne peut pas faire l’économie de ce temps, de telle sorte de parvenir à ne pas écouter l’autre à travers son propre fantasme. Il faut arriver à se dégager de son propre fantasme, l’avoir traversé et en faire le tour, pour ne pas recevoir l’autre à travers cette fenêtre dans laquelle chacun est pris. C’est ce qui prend du temps. Il faut tenir cette place pour pouvoir écouter l’autre.
Pour avoir une certaine distance entre l’analysant et l’analysé et pour que le regard que l’on porte ne soit pas biaisé.
Oui. C’est ça. Alors, il faut faire une analyse, mais pas seulement ça. Il faut suivre des séminaires, se former d’un point de vue théorique et avoir une expérience clinique. On est confronté à la clinique dès les études en psychologie. Mais tout le monde ne vient pas nécessairement de la psychologie. Il y a des gens qui n’ont pas été en contact avec la clinique. Il faut donc faire des stages.
Et pour débuter une analyse, il faut avoir une souffrance, des symptômes ou quelque chose à régler, une urgence.
On ne commence pas une analyse à des fins pratiques, instantanées.
Ce n’est pas une intellectualisation : je vais me faire analyser d’un point de vue intellectuel pour pouvoir… Non. Ce n’est pas ça la psychanalyse.
J’ai commencé mon analyse à vingt ans, à Paris, et quand j’ai immigré ici, j’ai continué mon analyse en France. C’est-à-dire que je faisais des allers-retours fréquemment. On peut imaginer le type de cure intense. J’y allais pour plusieurs séances par jour pendant des dizaines de jours. J’ai beaucoup aimé ça.
Il y avait une distance créée…
Je n’étais pas parasité par les problèmes du quotidien et on va plus à l’essentiel. À un moment donné, on va assez loin dans son analyse pour devenir analyste. Lacan disait : L’analyste ne s’autorise que de lui-même et de quelques autres. On ne devient pas analyste à partir d’une hiérarchie de l’institution psychanalytique. Ça s’expérimente sur le divan et on n’attend pas la fin de son analyse pour commencer à pratiquer. Chez les lacaniens, les analyses durent assez longtemps. Mais il y a une fin.
Il y a donc un côté public et un autre plus personnel ?
Absolument. On n’obtient pas de diplômes dans les séminaires, car on ne cesse de se former, de confronter son propre travail avec celui des autres. Tout analyste se doit de poursuivre sa formation.

Est-ce que vous travaillez dans d’autres institutions en tant que psychanalyste ?
Pour préciser une chose, il faut savoir qu’il y a une loi au Québec qui est passée en 2009 et entrée en application en 2012 sur la réglementation de la psychothérapie. Il faut maintenant avoir un permis. Il y a eu un débat chez les psychanalystes pour savoir s’ils étaient concernés par cette loi, et ce n’est pas encore tranché, mais la définition de la psychothérapie est tellement large que l’on ne peut plus reconnaître quoi que ce soit. Beaucoup d’analystes se sont retrouvés sous le coup de cette loi, et puisque je n’étais pas membre de l’Ordre des psychologues, il fallait que je choisisse. Grâce à une clause grand-père, j’ai pu finalement obtenir mon permis, essentiel pour pouvoir travailler dans les institutions.
Je travaille donc dans un centre de crise, le seul orienté par la psychanalyse à Montréal. J’aime travailler en équipe et j’aime aussi le type de patients que l’on y rencontre qui est différent de ceux qui se présentent à mon bureau. Je ne veux pas quitter le centre. J’y ai travaillé de moins en moins au fur et à mesure que le nombre de patients à mon bureau augmentait, mais, aujourd’hui, je suis encore sur la liste des employés et il m'arrive parfois de faire des remplacements. Ça m’intéresse beaucoup et je veux soutenir ce genre d’institution.
Pourquoi exactement avoir choisi d’être lacanienne plutôt que freudienne ?
Je ne suis pas sûre que, lorsqu’on est jeune et qu’on connaît un peu la psychanalyse, sans être pour autant analyste, l’on choisisse l’orientation que l’on prendra. D’ailleurs, on ne le choisit pas à ce moment-là. C’est l’analyste avec qui on décide de poursuivre notre analyse qui va orienter ce choix. J’ai rencontré à l’époque quelques analystes sans savoir de quelles écoles ils venaient. On ne pose pas ce type de questions. On arrive avec nos problèmes, l’analyste nous écoute et on essaie d’avancer, et ça clique ou ça ne clique pas. J'ai démarré mon analyse avec un premier analyste, mais je ne suis pas entrée dans l'École à laquelle il appartenait. J’ai ensuite eu une analyste avec qui quelque chose de significatif s’est produit, et ça a accroché. Je savais, en poursuivant avec elle, à quelle École elle appartenait. Les filiations se font souvent de cette façon.
Le choix est donc extérieur ? On ne peut pas choisir…
Je ne dis pas que l’on ne peut pas choisir. Ça dépend à quel âge on commence, de la rencontre qui opère et comment on rencontre la psychanalyse. La rencontre avec l’analyste se passe au-delà de l’orientation et des écoles. C’est plus tard que l’on peut faire un choix. En étudiant les textes, les théories, on peut ensuite s’orienter et mener à terme son parcours. Il faut savoir comment fonctionnent les théories. Lacan est freudien avant tout, mais les postfreudiens sont plutôt anti-lacaniens. J'ai d'abord rencontré Freud à travers mes lectures et mes études, puis découvert Lacan et les lacaniens. Une fois entrée dans l'étude de Lacan, et de l'orientation qu'en donne Jacques-Alain Miller, cela ne fit plus de doute pour moi que cette orientation était la plus claire et la plus éminente sur le plan de la clinique.
Ce sont des personnalités qui avancent les théories.
Ce qui est terrible, c’est que les gens qui critiquent Lacan ne l’ont majoritairement jamais lu.
Quel est votre type de patients ?
Dans ma carrière de psychologue, j’ai été en contact avec beaucoup d’enfants et de familles. C’est une très bonne expérience à acquérir, parce que c’est ce qui est le plus dur. J’ai aussi travaillé à l’hôpital psychiatrique, et plus tard, avec des patients en fin de vie. C’était les années les plus marquantes par le niveau de paroxysme du SIDA proprement dit (pas le VIH) avant que l’on ne trouve les traitements. Alors les patients atteints du SIDA, à cette époque, pour la plupart, mourraient. Je suivais les patients, pour la plupart, jusqu'au bout.
Comme analyste, c’est très large. En général, j’accepte tout le monde et il est assez rare que je refuse de recevoir quelqu’un. Je continue à voir des enfants, des adolescents. Je reçois aussi des psychotiques... et bien sûr, des névrosés. En fait, je reçois chacun comme il se présente, à partir de sa demande, avec ses questions, ses souffrances et ses symptômes.
Comment recevez-vous de nouveaux patients ?
Ça a beaucoup évolué au fil du temps. Cela va faire dix-huit ans que je pratique au Québec, et la façon dont venaient les nouveaux patients au début n’est plus la même aujourd’hui : j’ai toujours de nouvelles demandes. Je suis connue sur le plan local. Avec des collègues, il y a dix-sept ans, nous avons monté le Pont freudien, nous avons constitué NLS-Québec en septembre 2013 qui est un groupe associé à une École de psychanalyse internationale : la New Lacanian School (NLS), et nous venons de mettre en place un programme d’étude clinique, intégré à l’Uforca. Du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent à nos activités. Dans le milieu psychanalytique, où je me suis beaucoup investie et engagée, je suis connue. Même au-delà des lacaniens.
J’appartiens à une école reconnue, la NLS, qui elle-même fait partie de l’Association Mondiale de Psychanalyse, dont je suis membre.
Petite parenthèse : l’IPA, fondée par Freud représente tout ce que ce sont les normes psychanalytiques standardisées. Dans les années soixante, tous les psychanalystes reconnus, d’un certain niveau, étaient membres de l’IPA, dont Lacan. En 1963, il y a la scission, ou plutôt l’expulsion de Lacan, mais aussi de Françoise Dolto et d’un certain nombre de psychanalystes. On jugeait la pratique de Lacan non-standard aux normes établies par l’IPA. Lacan a beaucoup critiqué les postfreudiens, éloignés des théories de Freud. Il y a eu plusieurs groupes de lacaniens, et en 1992, Jacques-Alain Miller a fondé l’Association mondiale de psychanalyse (AMP) qui regroupe actuellement sept Écoles à travers le monde.
Je suis secrétaire de la New Lacanian School, qui est donc l’une de ces Écoles. Je participe à l’organisation des congrès un peu partout dans le monde et j’écris des articles de psychanalyse. Puisque le Québec est une terre d’accueil et c’est très important, la psychanalyse est dans beaucoup de pays plus familière qu’ici. En Amérique du Sud, en Europe. Il y a alors beaucoup d’immigrants qui arrivent avec mon adresse en poche.
Voilà la façon dont les nouveaux patients arrivent jusqu'à mon bureau.
Les immigrants sont un autre type de patient.
Je ne dirais pas qu’ils sont différents des autres patients, sauf pour avoir déjà été en contact avec la psychanalyse. Certains ont déjà fait une tranche d’analyse et c’est ça qui change.
Ils sont déjà initiés à la psychanalyse.
Oui. Ils ont déjà un rapport à l’inconscient, une écoute particulière de ce qui leur arrive, une lecture de ce qui se passe. La plupart ont une connaissance des processus de l’analyse quand ils arrivent ici.
Ils apportent alors leurs connaissances à l’établissement de la psychanalyse ici.
Oui. Quand on regarde les gens qui sont dans nos groupes, les Québécois sont en minorité.
Est-ce que vous avez d’autres projets en vue ?
Il est très difficile d’avoir du temps parce que je travaille comme une folle! Tous les jours. Enseigner est indispensable, parce que, d’un point de vue lacanien, soutenir l’enseignement est très important. Soutenir l’enseignement de la psychanalyse, c’est la transmettre. Quelqu’un des Presses Universitaires de Laval m’a contactée pour que j’écrive un livre. Je suis intervenue sur des thèmes de société comme la prescription de Ritalin en masse aux enfants (au Québec, l'un des taux de prescription les plus élevés du monde). J’ai aussi commenté des projections de films au Cinéma du Parc. Le livre serait un recueil d’articles que je modifierai pour ce dernier quand je disposerai de temps, après mon mandat à la NLS.
![Jacques Lacan [Sipa] Jacques Lacan [Sipa]](http://nls-quebec.org/sites/default/files/image%203%20entretien%20W.%20Delisle.jpg)
Quelle est votre perception des services en santé mentale au Québec ?
Sur le plan de la psychiatrie, je vais y aller fort, c’est totalement déplorable. On en a des exemples très concrets. Le Québec n’est pas un pays qui se porte mal au point de vue économique. Il y a un filet social, et cetera, et pourtant il y a pas mal de gens dans la rue. Au centre-ville, quatre-vingt-quinze pour cent de ces gens ont des problèmes de santé mentale. On revient à L’histoire de la folie, de Michel Foucault. Mais qu’est-ce qu’une société où l’on retrouve les malades mentaux dans la rue ? On en a eu cette année quelques exemples. Ce n’est pas normal d’abattre quelqu’un parce qu’il s’agite un peu ou fait peur. Quelqu’un qui délire, qui se retrouve dans la rue, est potentiellement perçu comme dangereux. Il peut l’être d’ailleurs. C’est un problème de société majeur. On est en plein dans l’actualité en ce moment avec l’attentat à Ottawa et celui de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce n’est pas que ça, car il y a des idées qui circulent et qui servent à ces jeunes, mais ces jeunes avaient des problèmes d'ordre psychiatrique.
Je reçois des patients psychotiques, et il m’est arrivé de devoir faire appel à des psychiatres. Je n’ai eu aucune réponse. Un patient qui veut rencontrer un psychiatre doit aller à l’urgence, ce qui est parfois une expérience très rude.
Nous recevons, au centre de crise, des patients qui ont fait des tentatives de suicide. Il n’y a pas nécessairement une psychose déclenchée, mais elle est là, et ces gens vont attendre à l’urgence pour rencontrer un psychiatre qui va les évaluer sur une grille et hop! ils sont remis dehors. Quand ils ont de la chance, ils ont les coordonnés du centre de crise ou bien ils nous sont immédiatement référés, mais dans la plupart des cas, ils se retrouvent dehors.
Cela veut dire qu’il y a moins d’hospitalisations. Elles sont plus courtes. Les personnes qui font une décompensation psychotique grave nécessitent une hospitalisation parfois longue, pour s’en remettre.
Les psychiatres en exercice au Québec sont formés essentiellement en psychopharmacologie. Ils évaluent les gens à partir de grilles qui analysent les patients en fonction des effets des médicaments. Il n’y a plus de repérage à partir de la nosographie psychiatrique classique, et à partir de l’écoute des patients. Cette psychiatrie classique avait ses fondements. Mais tout cela s’est fondu dans la psychopharmacologie. On reçoit des gens au centre de crise qui ont un diagnostic différent à chaque séjour.
Les patients s’en plaignent. Il n’y a plus de relation entre le patient et le médecin.
Les études en psychiatrie sont basées, en général, sur deux ans d’études en psychologie et le reste est de la médecine générale.
Et l’unique référence est le DSM-V, qui n’est construit qu’à partir de la pharmacologie. Ceci a des conséquences.
Si vous avez à changer quelque chose dans le système, qu’est-ce qui serait visé ?
Deux axes : le premier serait de reprendre la formation de psychiatre, qu’on reprenne l’étude des notions nosographiques classiques qui ont fondé la psychiatrie. Je ne parle pas contre les médicaments, au contraire. Il n'est pas question de sous-estimer l'apport des médicaments. Pour une personne qui souffre énormément, les médicaments sont nécessaires. Mais la nécessité n’est ni le surdosage, ni l’attribution systématique à tous les patients, ni la réduction du lien patient-médecin à une prescription. Il faudrait réintroduire une véritable formation clinique. Notre Programme d'Étude Clinique, dans lequel nous étudions les psychoses, est ouvert aux psychiatres en formation et aux psychiatres et médecins en général.
Deuxièmement, c’est au niveau des services psychiatriques. On ne doit pas penser qu’à réduire les coûts en termes de valeur comptable. Cette part de folie qu’a toute société, les marginaux, les troubles de santé mentale, doit être prise en compte. Ce ne sont pas des gens qu’on peut tuer parce qu’ils dérangent ou font peur dans la rue. Dans l’histoire de l’humanité, les gens sur le bord de dérailler sont aussi ceux qui ont apporté des changements majeurs et ce n’est pas une vision romantique de la chose. Ils sont allés plus loin sur le plan artistique, scientifique, et il y a des raisons à cela.
Pour finir, quel est votre opinion sur le milieu psychanalytique au Québec ?
Question difficile… La psychanalyse comme telle est pratiquement complètement absente dans cette société. Je vais vous raconter une anecdote : en 1996, il allait y avoir des élections fédérales et avait lieu le débat des chefs. La dernière question du débat porte sur l’indépendance du Québec. La journaliste commence à poser la question et s’évanouit, en direct. Le débat est arrêté. Le lendemain, on lit les journaux, on écoute la radio. Pas un mot sur la magnifique manifestation de l’inconscient. Elle incarne une profonde division qui habitait la journaliste. Les journalistes en France auraient sauté sur l’occasion pour se servir des théories freudiennes, et interpréter cette manifestation de l’inconscient. Ça fait partie de la société française, mais pas ici. On a expliqué l’évanouissement de la journaliste par la chaleur de la pièce et la ventilation de la salle de débat. Il y a un déni de l’existence de l’inconscient. C’est l’explication comportementaliste qui prédomine. Le plus grand échec est que la dimension de l’inconscient ne soit pas prise en compte.
Pour terminer, on est peu nombreux et il y a beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas chômer. Mais ce n’est pas négatif.
La psychanalyse est-elle pertinente au XXIe siècle ?
Oui, plus que jamais. Parce qu’il y a une perte de sens. Il y a une quantité d’idéaux, qu’ils soient politiques, familiaux, religieux, qui sont bouleversés. Il y a plein de gens qui vivent une perte de sens. Ils peuvent se rattacher à des idées extrêmes. C’est ce qui traduit un malaise dans la société. La psychanalyse est une réponse au un-par-un, pour que chacun trouve sa solution afin de se repérer dans sa vie, dans la société.
Merci beaucoup de m’avoir donné de votre temps et pour ces nombreuses explications.
William Delisle
23 octobre 2014
Références sur le Web :
Le Pont Freudien : http://www.pontfreudien.org/
NLS-Québec : http://nls-quebec.org/
New Lacanian School : www.amp-nls.org
AMP : http://wapol.org/
Uforca : http://www.lacan-universite.fr/