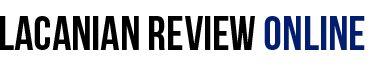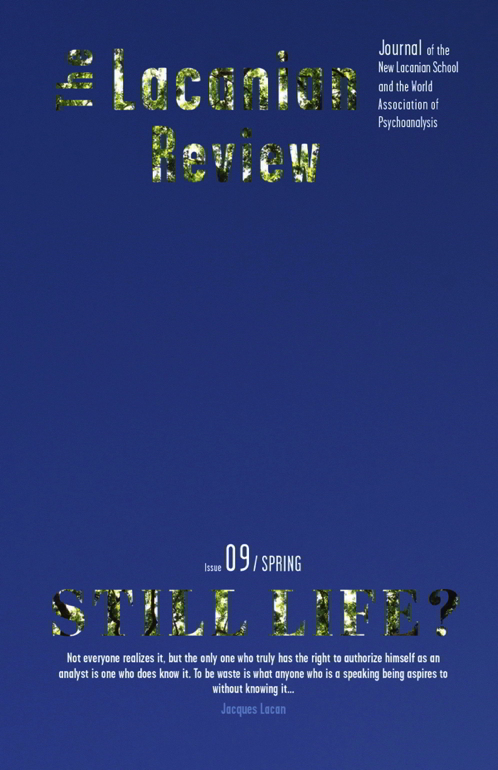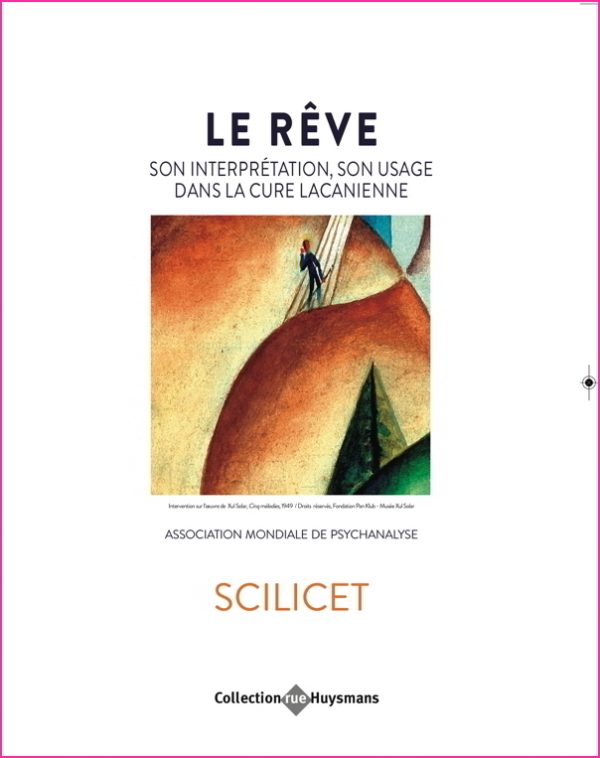Par:
Psychanalyse dans la cité / Psychoanalysis in the City
Dimanche 9 avril 2017
CAUSERIE
The Lacanian Review
La psychanalyse lacanienne s’écrit-elle seulement en français ? /
Is Lacanian Psychoanalysis written only in French ?
par Véronique Voruz
Rencontre animée par Benjamin Mortagne (éducateur spécialisé, membre de NLS-Québec, Montréal) et Eléa Roy (psychologue, membre de NLS-Québec, Montréal), à la librairie du Port de tête à Montréal.
Véronique Voruz est psychanalyste à Londres (Angleterre). Elle est Analyste de l’École (AE) de la New Lacanian School (NLS) depuis l’année 2015. Elle est membre de la NLS, de l’École de la Cause Freudienne (ECF) et de l’Association Mondiale de Psychanalyse (AMP). Elle est Directrice du Master de psychanalyse de l’Université de Kingston (Londres) et rédactrice de la revue anglophone The Lacanian Review.
Benjamin Mortagne : Bonjour à tous et merci d’être aussi nombreux avec nous pour cette rencontre, qui a lieu dans le cadre des 4èmes Journées d’étude de la New Lacanian School-Québec (NLS-Qc) ayant pour titre Place et interprétation des formations de l’inconscient. Nous accueillons en cette fin de journée le Docteure Véronique Voruz, venue directement de l’Angleterre, et nous la remercions de se prêter à cette causerie autour de la revue The Lacanian Review, qui est la revue de la New Lacanian School (NLS) et la revue anglophone de l’Association Mondiale de Psychanalyse (AMP). Je vous rappelle que cette causerie peut se faire en français et en anglais. À vous de choisir pour ce dialogue.
Eléa Roy : Véronique Voruz est l’auteure de nombreuses publications dans des revues académiques et psychanalytiques. Elle est la Directrice du Master de psychanalyse à l’Université de Kingston et professeure en criminologie à l’École de droit de l’Université de Leicester. Elle est psychanalyste à Londres et membre de la New Lacanian School (NLS), de l’École de la Cause Freudienne (ECF) et de l’Association Mondiale de Psychanalyse (AMP). Elle est rédactrice de la revue The Lacanian Review.
Tout d’abord, pouvez-vous partager avec nous comment a émergé le désir de créer cette nouvelle revue anglophone ?
Véronique Voruz : Premièrement, je vous remercie d’avoir organisé cet événement. C’est très sympathique de pouvoir parler de ce projet avec vous. C’est particulier de présenter une revue anglophone en français, mais comme mes collègues l’ont dit, nous pouvons changer de langue quand vous le voulez. Tout d’abord, The Lacanian Review prend la suite d’une autre revue, qui s’intitulait Hurly-Burly revue de l’école anglophone de l’Association Mondiale de Psychanalyse (AMP), la New Lacanian School (NLS). Nous avons décidé, il y a maintenant un an et demi, de lancer une nouvelle série de cette revue pour mettre au premier plan le fait qu’il s’agit d’une revue de psychanalyse lacanienne, puisque Hurly-Burly n’était pas un signifiant très clair de ce point de vue. On en a fait non seulement une revue de la NLS, mais aussi la revue anglophone de l’AMP, pour ne pas s’adresser uniquement à des gens membres de l’École, et aussi pour indiquer notre souhait de dialoguer et de converser avec des personnes s’intéressant à Lacan et à la psychanalyse lacanienne dans un contexte anglophone. Nos deux premiers thèmes indiquent bien notre désir de dialoguer avec ceux qui s’intéressent à la psychanalyse, hors du champ clinique de celle-ci, puisque nous avons mis comme pièce centrale de chacun des numéros que nous avons faits jusqu’à présent le dialogue ; un dialogue entre une personne représentative du thème de la revue dans le monde anglophone et une personne représentative du même thème, mais dans le monde francophone. Le but était objectivement d’essayer de se pencher sur ce que nous percevions être un malentendu entre les tenants de la psychanalyse dans le monde francophone, plus généralement de langue latine, et ceux du monde anglophone – deux approches de la psychanalyse qui n’arrivaient pas à communiquer. Or, c’était pour nous une problématique importante pour la transmission de la psychanalyse dans le monde anglophone, et donc répondre à ce malentendu était nécessaire, à travers des dialogues qui se tiennent au même lieu, le lieu qu’est cette revue. Même si nous ne croyons pas à la communication idéale !
Par exemple, dans le premier numéro qui s’appelle « Oh my Gods ! », sur les religions – un thème fondamental de notre temps où les religions s’affrontent, que ce soit les religions au sens classique et aussi bien la religion de la science, du chiffre ; la religion dans le sens de ce en quoi on croit –, nous avons ainsi mis en conversation un historien français des guerres de religions, Denis Crouzet, qui est professeur à la Sorbonne et grand spécialiste de cette période en France, avec un historien anglais, Diarmaid MacCulloch, qui est professeur en théologie et en histoire des religions à Oxford, et notamment spécialiste de la période de la Réforme en Angleterre. Leur conversation a mené à une série d’interprétations sur l’histoire des religions, sur la question du monothéisme et de ce qu’il devient au moment où les monothéismes doivent coexister – qu’est-ce que c’est qu’un monothéisme quand il est sur le même territoire que d’autres monothéismes ? Il y a déjà une contradiction dans les termes mêmes qui nous pousse à nous interroger sur la situation du monothéisme en tant que tel. Prenez par exemple cette translation d’un monothéisme à l’autre : la juridisation de l’Islam par la « contagion » de la religion juive. La revue a donc permis à ces deux spécialistes d’exprimer leurs opinions sur ce que l’on peut appeler aujourd’hui une nouvelle période de guerres de religions.
Le dialogue, d’une part donc, entre les personnes anglophones et les personnes francophones, permet de créer un lieu où le malentendu des langues pouvait trouver à s’entendre, au moins à trouver un espace de conversation. L’autre fonction du dialogue est aussi de mettre en contact le champ psychanalytique clinique et le champ de la pensée qui s’intéresse à la psychanalyse comme étant une des références fondamentales de la pensée occidentale. Par exemple, l’historien Denis Crouzet est très influencé par le concept lacanien de l’imaginaire. Il présente aussi une interprétation des guerres de religions à partir de l’angoisse, notamment eschatologique, en tant que déclencheur de la guerre. Ainsi, l’idée était également de créer un dialogue entre les personnes qui se servent de la psychanalyse comme d’un outil théorique ou méthodologique, et les personnes qui pratiquent la psychanalyse à partir de la parole analysante. L’objectif de la revue, en plus de ce que Hurly-Burly apportait comme outil propre à notre champ, est donc devenu de porter la psychanalyse au rang du dialogue, à la fois entre le monde anglophone et francophone et entre le monde clinique et culturel – les deux dimensions dans lesquelles se transmet la psychanalyse à travers le monde.
Pour le deuxième numéro, nous avons mis en conversation un professeur trans* d’une université américaine – une personne qui, indifféremment et selon les moments de sa vie, va se faire appeler soit he ou she, soit Jack ou Judith, et qui a cette identité de la fluidité du genre, c’est-à-dire qui refuse de rester dans un genre ou dans l’autre, sans transition réelle, qui est trans* au sens d’un signifiant sans signifié, qui se représente elle/lui-même par un signifiant qui n’a pas de signifié fixe. Nous avons donc demandé à ce professeur, Jack Halberstam, d’être en conversation avec Marie-Hélène Brousse, psychanalyste de l’ECF et qui venait de faire un séminaire à l’ECF intitulé Identity Politics1, en partie en réponse aux attentats de janvier et novembre 2015 à Paris et aussi à la réaction Je suis Charlie et Je suis en terrasse. Cette question du « Je suis » interroge la définition de l’identité aujourd’hui, et elle nous est apparue être une personne appropriée à mettre en dialogue avec cette personnalité américaine, pour qui les question d’identité sont énormément liées aux revendications d’une reconnaissance, d’une différence non-hétéronormée. Le champ de la sexualité et du genre étant encore une fois le lieu d’un malentendu très profond sur la façon dont est appréhendée la psychanalyse dans le milieu des cultural studies, des queer studies et des gender studies, et la façon dont la question de la sexuation est appréhendée dans l’orientation lacanienne. Nous avions envie de donner à ce malentendu une place pour pas que l’on puisse dire « l’autre n’a rien compris », mais plutôt de dire ce que chacun avait compris de la position de l’autre et de repérer ce qu’ils avaient en commun.
Dans le troisième numéro qui s’intitule « Ségrégations », au pluriel – puisque nous vivons dans une époque où les ségrégations sont de plus en plus marquées –, la thèse soutenue dans ce numéro voit dans le Identity Politics – mouvement qui trouve ses racines dans une optique bien intentionnée des politiques de la reconnaissance de l’autre, de l’altérité, de trouver chacun sa voie, chacun sa place – devenir elle-même une stratégie ségrégative, puisque les personnes se reconstituent en groupes de plus en plus fragmentés. Nous avons essayé d’appréhender, d’offrir des abords théoriques à cette question. Ce numéro va sortir dans deux semaines et sera sous-titré « le désir comme subversion de l’identité », c’est-à-dire ce qu’offre la psychanalyse : une orientation, non pas sur l’identité, mais sur le désir. On ne ressort pas d’une analyse avec son identité en poche, mais, avec un petit peu de chance, on en ressort en sachant quelque chose sur son désir. Ce que la psychanalyse peut nous offrir comme orientation politique est déségrégatif. On voit très bien d’ailleurs que les trois numéros s’inscrivent dans une logique de construction d’un thème déségrégatif, par le dialogue entre les langues, entre les disciplines, entre les cliniciens et les philosophes, les théoriciens.
Benjamin Mortagne : Effectivement, il y a toujours une première partie qui traite d’un axe thématique qui est en lien avec les enjeux contemporains. On remarque une place très importante qui est faite entre la théorie et la clinique. En quoi cette place est importante ?
Véronique Voruz : Comme nous sommes psychanalystes, nous savons l’importance des signifiants. Le dossier thématique consiste en une exploration des signifiants qui structurent un champ. Qu’est-ce qui se dit aujourd’hui des religions ? Qu’est-ce qui se dit de la sexualité ? De la ségrégation ? Nous procédons ainsi au moyen d’un repérage signifiant, sachant que, dans notre approche, le sujet est l’effet des signifiants qui, à un moment donné, organisent et représentent son existence d’être parlant, dans un lieu et un temps donnés. Les sections thématiques visent à explorer les réseaux signifiants qui nous enserrent et au moyen desquels nous essayons d’attraper quelque chose de ce que c’est qu’un corps vivant à une époque. C’est le premier élément très important de notre approche : le repérage signifiant, le repérage symbolique et le repérage de ce qui peut se dire du moment dans lequel nous vivons. Ainsi, nous interrogeons des analystes, des historiens, des philosophes, des personnes qui ont des choses à dire sur notre modernité, pour voir comment la chose est prise, la psychanalyse étant toujours un discours sur un autre discours, et non pas un discours en elle-même – sinon elle deviendrait elle même une modalité du discours du maître –, elle se doit de d’abord repérer ce qui se dit dans les discours dominants de l’époque.
La section thématique est destinée à accomplir ce premier repérage, et à essayer de donner à ce qui se dit dans un épistémè – l’ensemble des savoirs d’une époque – une orientation analytique, une orientation tirée du réel, c’est-à-dire ce que les discours ne peuvent pas prendre au filet du signifiant. Si on lit un peu Foucault, on sait que chaque époque, chaque épistémè, produit un résidu qui lui est spécifique. Lorsque je parle de ce quelque chose qui ne se prend pas dans le filet du signifiant, je dis bien quelque chose du corps vivant qui résiste, de structure, à être pris au filet du signifiant. L’orientation analytique se fait à partir de ce reste. On commence par le repérage discursif pour ensuite faire l’analyse de ce reste, ce que nous appelons le réel, ce qui du réel va finalement faire le cœur d’une existence. Si on suit la définition lacanienne du symptôme inspirée de Marx, le symptôme est une subversion, ce qui résiste au savoir d’une époque. Notre orientation est sur ce point-là, sur ce point de symptôme en tant que subversion d’un savoir, aussi bien que le reste, le déchet d’une symbolisation. Dans notre approche, la symbolisation est une mortification ; ce qui reste est ce qui reste vivant, aussi bien ce qui résiste à être mis en ordre, en réseau, symbolisé et mortifié.
Dans un deuxième temps, la revue s’attache également à témoigner de notre clinique. Nous avons une section sur ce que c’est que la formation des analystes. Nous prenons notre orientation des indications de Jacques Lacan qui dit : « Il n’y a pas de formation de l’analyste, il n’y a que des formations de l’inconscient ». On se forme à être psychanalyste, non pas en acquérant un savoir, mais bien en se formant d’abord à ce que c’est que l’inconscient, pour ensuite former son inconscient à la pratique de la psychanalyse. C’est pour cela que, dans cette section, nous avons des textes qui traitent de questions pratiques de notre formation, c’est-à-dire le contrôle et la garantie. Nous publions également, dans cette rubrique, les témoignages des Analystes de l’École, c’est-à-dire des analystes qui témoignent eux-mêmes de leurs expériences d’analysants, puisque nous avons également ce problème juridique de ne pas pouvoir publier trop de matériel clinique pour des raisons de confidentialité. Donc, nous avons choisi de donner une place à la clinique par le biais de personnes, d’une part, qui témoignent elles-mêmes de leurs expériences – une parole toujours plus juste par rapport à la construction théorique qu’un analyste peut faire d’un cas –, et d’autre part, des personnes pour lesquelles la question de la confidentialité ne se posait pas, puisque nous décidons nous-mêmes de publier nos propres cas au titre d’un enseignement de ce qu’est une analyse aujourd’hui.
Nous publions également des textes d’orientation pour les congrès qui précèdent et suivent la publication de la revue. Ainsi, dans le prochain numéro « Ségrégations », nous trouvons à la fois des textes prononcés au congrès de Rio sur le thème du « Corps parlant », et des textes d’introduction au congrès de Barcelone sur la psychose sous transfert – thème proposé par Miquel Bassols à Madrid – et au Congrès de la NLS sur les formations de l’inconscient. Toutes ces choses-là se retrouvent encore une fois dans l’idée de mettre en dialogue le repérage signifiant et ce que nous faisons à partir de ce qui n’est pas symbolisé par les discours d’une époque. C’est notre clinique qui prend son point d’origine du point de résidu des discours. C’est dans ce sens-là que la revue est construite. Vous voyez qu’elle procède d’une grande logique.
Benjamin Mortagne : Il y a aussi la version « online » qui est disponible une fois par semaine…
Véronique Voruz : Au moment où nous avons décidé de transformer Hurly-Burly en The Lacanian Review, nous avons décidé de créer un site internet qui se nomme The Lacanian Reviews. Ce site réunit LRO – Lacanian Review Online – et The Lacanian Review qui est la revue publiée sur papier mais aussi en format Ebook et Kindle à raison de deux numéros par an. Chacun de ces éléments ont une présence électronique, puisque LRO est publiée électroniquement une fois par semaine et que The Lacanian Review a lui aussi une version électronique pour des raisons pratiques, notamment pour la diffusion en milieu universitaire. Ils sont disponibles sur le site de l’ECF-Échoppe.
Eléa Roy : Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi Lacan et ses apports, sa théorie et son éthique, sont d’une aide précieuse pour aborder la clinique, les enjeux contemporains, les symptômes ?
Véronique Voruz : Merci pour cette question sur laquelle on pourrait parler pendant des heures. On peut déjà commencer par dire que nous vivons aujourd’hui dans le paradigme de la biopolitique sanitaire. Ce concept de biopolitique a été inventé par Michel Foucault pour nommer un mode de gestion du vivant, apparu comme un objectif politique à la fin du 19ème siècle dans le cadre de l’émergence du libéralisme. On se retrouve aujourd’hui dans un contexte d’extension énormément développée de ce concept dans les sociétés démocratiques occidentales, c’est-à-dire les sociétés qui font de la gestion de la santé, de la vieillesse, de la reproduction, de tout ce qui concerne la vie des individus, un objectif primordial de gouvernement, mais aussi un vecteur de croissance économique. On le voit dans les rapports de l’Organisation Mondiale de la Santé ou dans tous les programmes développés par l’Union Européenne pour gérer les questions de la maladie mentale, de la maladie physique, du vieillissement de la population, etc. Nous vivons cette époque de la gestion bureaucratique du vivant, avec la mise en place de protocoles à des niveaux très éloignés de la rencontre avec les corps vivants de la clinique.
Il y a une optique de bonnes intentions qui est de fournir un accès aux soins, un soin remboursé, mais on arrive à des choses qui sont complètement folles. On voit les statistiques de l’Union Européenne qui disent que plus de 30% de la population souffrent d’un trouble mental, qu’une personne sur quatre est déprimée, etc. Si on lit les rapports de l’OMS, il y a des prédictions pour 2030 où la santé mentale sera le premier poste de dépenses dans nos sociétés. On a en même temps cette idée d’une crise permanente, avec la vision du DSM selon laquelle toute souffrance psychique est catégorisée comme un symptôme psychiatrique. Si on fait un recensement dans ce sens, on est tous des malades mentaux. Et si on est tous des malades mentaux, on a l’obligation de répondre, par une réponse gouvernementale, à ce qui est perçu comme un problème dans la gestion du vivant et ce, avec le paradigme médical. Le trouble mental est perçu comme une « maladie mentale », les personnes qui sont qualifiées pour y répondre sont les médecins, et ils opèrent au moyen de protocoles selon le paradigme des données probantes, du meilleur traitement.
Il ne s’agit pas de critiquer ou pas ce contexte-là. Il s’agit de reconnaître que l’on est dans ce contexte. La parole y est peu valorisée, puisqu’on a l’idée que les personnes souffrantes relèvent d’un soin plutôt médical, c’est-à-dire qu’il faut pouvoir répondre avec les meilleurs outils de notre science. On le voit très bien dans l’élaboration de nouvelles médecines, notamment la psycho-pharmaco-génétique, qui propose de créer une pharmacologie adaptée au phénotype de chaque individu et selon la réaction de chaque phénotype aux types de molécules. On a ici l’idée de la réponse médicale à la souffrance individuelle. Dans cette orientation, on voit très bien que la place de la parole est réduite à une fonction de la communication, c’est-à-dire que la personne doit communiquer des éléments sur sa souffrance qui vont permettre une réponse médicale protocolaire et au mieux une réponse sur le modèle de la médecine individuelle ou psychopharmacologique – reformatage du cerveau selon les IRM fonctionnelles, ce qui permet de rééduquer certains patterns cognitifs etc. Or, très souvent, les personnes qui viennent rencontrer un professionnel de la santé mentale veulent parler de leur souffrance et surtout être entendues plus de dix minutes. Elles veulent être entendues sur la difficulté qu’elles ont à gérer ce qu’on appelle la jouissance, c’est-à-dire les pensées intrusives, les difficultés à réguler leurs corps, les choses sur lesquelles la médicalisation n’a pas de prise. Freud disait que ce qui est difficile pour un être humain, ce ne sont pas les dangers extérieurs, mais les dangers intérieurs, les exigences pulsionnelles auxquelles le sujet ne trouve pas de frein. Lacan le disait aussi très bien en décrivant le problème de la société capitaliste qui produit de la jouissance sans satisfaction. La satisfaction d’une exigence pulsionnelle vient apaiser un temps donné afin que le sujet puisse respirer, prendre un temps satisfait pour passer à autre chose. Or, notre société capitaliste produit plutôt des objets qui donnent une jouissance qui n’est pas satisfaisante au sens de pouvoir introduire une pause, une temporalisation de la demande pulsionnelle.
La psychanalyse, à mon sens, est ce qui vient introduire une temporalité, un temps pour comprendre nécessaire à l’après-coup, alors que nous vivons dans une culture de la succession d’instants. On passe d’une chose à une autre, puisque tout est accessible instantanément. Il n’y a donc pas de temps nécessaire à la structuration du désir. On est pris dans cette logique qui peut amener à des symptômes difficiles pour les sujets et auxquels la médecine n’a pas de réponse. La psychanalyse offre de réintroduire cette temporalité, cette pause, dans l’expérience subjective.
Benjamin Mortagne : On le voit bien ici en Amérique du Nord, mais toute la clinique du DSM et de l’évaluation commence à débarquer en Europe. Est-ce que le milieu anglophone est aussi touché ? J’ai remarqué une visée politique à la revue – on a sous-titré la conférence d’aujourd’hui « La psychanalyse lacanienne s’écrit-elle seulement en français ? » Est-ce qu’il y a cette volonté de toucher le milieu anglophone ?
Véronique Voruz : Tout à fait. D’une part, la psychanalyse existe là où il y a un analyste. Le problème de la transmission de la psychanalyse, et je parle du pays où je travaille qu’est l’Angleterre, c’est l’absence d’analystes lacaniens. La psychanalyse ne se transmet pas sans analyste et sans expérience analytique. Du moment où il y a un analyste, il n’y a pas de raison que la psychanalyse se laisse arrêter par la barrière de la langue. La langue de la psychanalyse, c’est la langue de l’inconscient et on en a tous un, jusqu’à preuve du contraire… Marie-Hélène Brousse, qui est la directrice de la publication, avait un désir très fort de transmettre la psychanalyse dans le monde anglophone, puisqu’elle vient souvent aux États-Unis, notamment à New York et Miami, afin de contribuer au travail qui s’y fait. Pour ma part, ce désir de transmettre la psychanalyse dans sa dimension d’expérience analytique, non pas dans sa dimension discursive – elle est déjà présente sous cette forme –, vient de rencontres que je fais avec des sujets désespérés. En Angleterre, la psychiatrie est devenue une psychiatrie de prescriptions. Il n’y a plus de lieux d’écoute et quand il y en a, ils sont peu orientés ; on parle d’orientation existentialiste ou de bonnes intentions, d’empathie, d’écoute active pour « faire du bien », d’aide sur l’opinion de soi, etc. Or, ce qui n’est pas pris en compte sont les ravages de la pulsion. La psychothérapie bien intentionnée ne réussit pas à traiter les ravages de la pulsion, ce qui mène évidemment au constat de l’inefficacité de la psychothérapie et au renvoi des patients vers le médical. On peut entendre : « Ça ne sert à rien de parler, puisque les gens qui parlent ne vont pas mieux ». On a cette situation où les gens sont pris dans un étau entre une pratique de la parole qui existe mais qui n’est pas efficace et une pratique médicale qui est efficace mais dans le sens d’une « camisole chimique », qui permet de contenir les symptômes sans permettre une subjectivation du ravage dont une personne peut faire l’expérience. Lorsqu’on est confronté à des personnes en grande souffrance qui sont ballottés d’un pôle à un autre, on peut avoir cette idée de l’urgence de réintroduire une forme de parole efficace dans le monde anglophone. J’ai vu des personnes de cinquante ans en bout de course, qui se promenaient depuis vingt ans de diagnostic en diagnostic, avec de nombreux traitements. On a donc cette idée de l’importance que la psychanalyse existe, pour que les sujets puissent faire front face à ce qui pourrait les envahir.
Ruzanna Hakobyan : Où sont les pôles d’intérêt où la revue est en demande ?
Véronique Voruz : La commercialisation se fait principalement par les groupes d’intérêt à travers le monde, ceux qui font l’effort de la rendre publique afin de la faire connaître. Bien sûr, comme je vous l’ai dit, nous voulons toucher un public qui n’est pas seulement composé d’analystes. Alors, nous prenons contact avec des universités pour qu’elle soit accessible dans les bibliothèques, on la rend numérique pour les étudiants, etc. C’est tout un travail, dont l’événement d’aujourd’hui fait partie. L’accessibilité se fait aussi à partir de notre champ, qui s’inscrit dans les thèmes actuels. Nous avons parlé des religions, de la sexualité, des ségrégations. Je peux vous dévoiler le quatrième thème : qu’est-ce que la famille aujourd’hui ? Qu’est-ce qu’une famille aujourd’hui, quand on peut avoir le matériel génétique de six personnes dans la « création » d’un enfant ? On peut imaginer le scénario ultime d’une personne avec une greffe d’un utérus d’une autre personne, le sperme d’encore une autre personne. On peut imaginer ces modèles de familles qui ne répondent plus à l’hétéronormativité et même, au-delà de ça, au binaire. On peut imaginer des familles où il n’y a pas deux parents ; il y en a trois, quatre… Ainsi, dans le droit anglais, on peut donner des droits parentaux aux donneurs de sperme. Alors, on assiste au démembrement de l’autorité parentale. On voit également une consécration de la relation affective. Deux personnes habitant ensemble peuvent se faire reconnaître des droits, même si elles ne sont pas mariées, ni en couple. C’est donc une extension de ce que c’est qu’un lien, qui n’est pas le lien de la famille, ce qui régissait l’histoire de l’humanité. On avait l’idée qu’une famille s’articulait autour de la reproduction et de l’éducation des enfants. Aujourd’hui, on a de moins en moins ces restrictions sur ce qu’est un groupe humain. Qu’est-ce que c’est qu’un groupe humain quand il n’est pas uni par les liens du sang, par les liens de la filiation, par les liens de la reproduction ? Il nous est apparu très important de poser ces questions, puisqu’elles impliquent des remaniements conséquents sur ce qu’est le lien social, le tissu social. Qu’est-ce que notre pratique analytique lorsqu’on reçoit un enfant d’un couple d’homosexuels et demain, on ne sait même pas quoi ? Cela a une énorme portée sur les enfants. Si je fais de la science fiction, on pourrait penser à un enfant cloné à partir du matériel génétique de sa mère. Ce sont des choses qui sont discutées dans le milieu scientifique. Qu’est-ce que c’est qu’être le clone de sa mère ? C’est particulier…
Voilà les questions que nous allons envisager dans le prochain numéro. On va essayer d’avoir un dialogue avec un généticien ou des personnes qui sont impliquées dans ce type de pratiques. François Ansermet, par exemple, est psychiatre dans un service pour les enfants et qui travaille ces questions par rapport à la reproduction, par rapport aux effets de sujet dans la science. Ruzanna Hakobyan me disait combien il était fréquent d’utiliser la science dans les pratiques reproductives au Canada ; pour reprendre une phrase de François Ansermet : « Que sont les enfants de la science ? ». Vous voyez que l’on traite de thèmes qui ont une importance bien au-delà de notre champ, puisqu’on a une civilisation qui se modifie extrêmement rapidement.
Ruzanna Hakobyan : Et pourtant, on ne peut pas séparer la psychanalyse de tout ça. On entend dans nos bureaux des sujets qui nous parlent de ce changement.
Véronique Voruz : Dans nos cabinets, nous entendons les effets sur les corps vivants des discours qui organisent notre vie. Ce que disent ces personnes n’est entendu presque que par nous. C’est à partir de ça que l’on peut construire un savoir sur les effets de ces discours sur les corps vivants. C’est là que ce savoir est constitué de leur parole, de leur expérience. On est enseigné par une parole qui se recueille dans un lieu unique. À partir de cette parole et par le moyen de ce dispositif analytique, on peut en retirer un savoir qui n’est pas le même que le savoir-signifiant des discours constituants. C’est une manière de rentrer ce savoir d’une parole unique dans un savoir plus abstrait.
Fernando Silveira Rosa : Je voulais savoir s’il va y avoir un effort pour dialoguer avec la tradition psychanalytique anglaise de Winnicott, Mélanie Klein, etc.
Véronique Voruz : C’est une excellente question. On a quand même l’idée que l’Angleterre et les États-Unis sont des pays où les traditions psychanalytiques ont été très fortes. Par exemple, en Angleterre, nous avons l’Institut Tavistock, Winnicott, Bion, Anna Freud, Mélanie Klein ; il y a eu énormément de psychanalystes anglais qui ont laissé une marque très importante sur la culture psychanalytique. On a quand même l’impression que les psychanalystes anglais, à l’heure actuelle, se sentent dépassés par la modernité et, pour se mettre au goût du jour, préconisent des techniques telles que la mentalisation, la neuropsychanalyse ; en essayant de rendre compte de l’inconscient comme étant les traces mnésiques dans le cerveau, en essayant d’interpréter la psychanalyse dans ce sens-là.
Or, je pense que notre orientation est celle qui ne cède pas sur la radicalité de ce qu’est la psychanalyse. J’aime beaucoup ce que dit Éric Laurent dans son livre Lost in Cognition2 où il explique que la mémoire n’est pas la conservation de l’expérience, mais la non-conservation de l’expérience. On ne se rappelle pas de ce qui nous est arrivé, mais on se rappelle de la version fantasmatique de ce qui nous est arrivé, et on ne peut pas rendre compte de cela par la neuropsychanalyse. Nous assistons à l’abandon de la radicalité de la psychanalyse par les analystes anglophones. Nous essayons non pas de convertir les psychanalystes anglais à la tradition lacanienne, mais plutôt de montrer ce qui fait la spécificité et a rigueur de notre formation et notre orientation. C’est pour cela que nous avons une section sur la formation où nous disons ce qu’est le contrôle, sur comment on se forme dans l’orientation lacanienne. Notamment, nous avons publié des textes-clé comme celui d’Éric Laurent sur la logique de la supervision à l’époque du parlêtre, ou celui de Jacques-Alain Miller prononcé à la journée de l’ECF Question d’École sur le désir de contrôle. On essaie de donner quelques repères pour des analystes qui s’intéressent à l’orientation lacanienne. La garantie, le contrôle, la formation. Nous avons très souvent l’écho de personnes dans le milieu anglophone sur le grand intérêt qu’ont pour eux les cas des AE. Ce ne sont pas des cas articulés par la logique freudienne du sens, mais plutôt autour de la question pulsionnelle et de l’efficacité de la parole sur le traitement de la pulsion. Il y a un effet de surprise qui est produit chez ces personnes à la lecture de ce qu’est une psychanalyse lacanienne. C’est une psychanalyse qui n’essaie pas d’être en consonance avec les discours de la science, mais qui au contraire se revendique de sa particularité qui continue malgré le développement de la science. On sait très bien que la science ne peut pas empêcher une personne de penser – on peut prendre un Viagra si on a des problèmes érectiles, mais c’est plus souvent une question de désir qu’une question organique. La science ne peut pas aider tout ce qui est la question du désir. Comme Lacan le dit dans le Séminaire X, la psychanalyse est une « érotologie »3. C’est un discours sur le désir. Ce n’est pas un discours sur la santé mentale. C’est ce qu’on essaie de transmettre. Il y a un problème qui vient de notre part, d’avoir voulu mettre la psychanalyse dans le champ de la santé mentale. Or, la psychanalyse ne soigne pas une maladie. Même si ce qui s’enseigne d’une psychanalyse peut permettre une écoute, un accueil, de personnes qui souffrent de conditions psychiques sérieuses, on fait une psychanalyse non pas parce qu’on est malade, mais parce qu’on a un problème au niveau du désir.
Eléa Roy : C’est tout l’enjeu actuel de différencier la psychanalyse de la psychothérapie.
Véronique Voruz : Tout à fait.
Benjamin Mortagne : Merci beaucoup Véronique pour ce temps qui nous a été accordé et pour votre générosité.
[Applaudissements]
Transcription : William Delisle
1 Brousse Marie-Hélène, « Identity Politics avec Lacan. Lien social et identification avec du Y a de l’un », ECF, 2015-2016 (disponible sur Radio Lacan : http://www.radiolacan.com/fr/topic/704/3).
2 Laurent Éric, Lost in cognition, psychanalyse et sciences cognitives, Nantes, C. Defaut, coll. Psyché, 2008.
3 Lacan Jacques, Le Séminaire, Livre X, L’angoisse, 1962-1963 (J.-A. Miller, éd.), Paris, Seuil, 2004, p. 24.